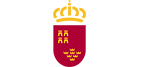Georges de peyrebrune et la cause des femmes
Lydia de Haro Hernández
Universidad de Murcia
Résumé : Georges de Peyrebrune fut l’une de ces femmes pionnières du XIXème siècle qui osèrent faire de l’écriture leur métier et qui parvinrent à se gagner une place dans la scène littéraire, toutefois monopolisée par le genre opposé. L’œuvre de cette romancière fait preuve non seulement d’un talent littéraire incontestable mais aussi d’un engagement avec la cause féministe. C’est justement cet aspect que nous aborderons lors de notre communication, à travers le commentaire d’une série d’extraits choisis nous permettant d’explorer sa vision des rapports homme/femme et ses convictions à l’égard de l’émancipation de celle-ci. La redécouverte des textes de ces femmes de lettres, oubliées et écartées du canon, pour évaluer leur contribution à l’Histoire littéraire devient parallèlement un voyage aux origines des transformations d’une nouvelle femme.
Mots Clés : XIXe siècle ; Féminisme ; Littérature féminine ; Femme-auteur ; Georges de Peyrebrune.
En septembre 1907, le magazine encyclopédique illustré Je sais tout dédiait un article au phénomène de l’« envahissement » progressif du domaine littéraire par les femmes. Visiblement ébahi de « l’abondance tout à fait nouvelle de talents féminins » (Anonyme 1907 : 159), l’auteur dudit article, intitulé « Cinq mille femmes de lettres », se permettait de vaticiner l’augmentation successive et graduelle du nombre de femmes-écrivains tel qu’il l’aurait fait pour une épidémie virale. En effet, il affirmait que s’« il n’y en avait que mille il y [avait] vingt ans ; il y en [aurait] dix mille dans dix ans et ainsi de suite » (Anonyme 1907 : 160). La cause et/ou conséquence directe de cet accroissement serait, d’après lui, le fait que « les préventions des familles, voire les préventions des maris [commençaient] à s’évanouir » (Anonyme 1907 : 160) et que « le préjugé du public contre les livres signés de noms féminins [tombait] de jour en jour, quoique n’étant pas tout à fait éteint » (Anonyme 1907 : 164).
Apparemment poussé par une certaine sympathie envers celles-ci, il invitait par la suite son lectorat à se détacher de « la légende qui [faisait] de la femme écrivain une sorte de monstre » (Anonyme 1907 ; 160), en essayant de réconcilier l’image diabolique de la femme de lettres – ce « personnage hybride » (Planté 2015 : 26) qui faisait trembler les bases de la famille traditionnelle et, plus largement, l’ordre social établi, – avec l’idéal féminin classique de « l’ange du foyer »1. De cette façon, on mettait l’accent sur la figure de la femme-auteur et la transformation expérimentée par celle-ci, car cet être jadis considéré mi-homme mi-femme, ni l’un ni l’autre en somme, se permettait désormais de « rester femme » en même temps qu’auteur, sans ne plus devoir se déguiser en homme ni négliger ses fonctions naturelles au sein du ménage (Anonyme 1907 : 160). Une sympathie moins manifeste – plutôt fausse galanterie – est celle que montraient les deux « maîtres de la littérature contemporaine », Émile Faguet et François Coppée – tous deux membres de l’Académie française –, interrogés à l’occasion. Ce n’est qu’après avoir méprisé d’un air de condescendance soit l’intelligence des femmes en général soit l’art d’écrire devenu métier, qu’ils accordèrent leur approbation à la présence de ces dernières dans un territoire dont l’homme avait eu le contrôle absolu jusqu’alors (Anonyme 1907 : 159-160). La réalité était donc loin d’une parfaite entente entre consœurs et confrères. La plupart de ces derniers se sentît peut-être encore étouffée de cette « odor di femina » émanant des écrits des femmes qui perturbait autant Barbey d’Aurevilly à peine une trentaine d’années auparavant.
Les femmes peuvent être et ont été des poëtes, des écrivains et d’artistes, dans toutes les civilisations, mais elles ont été des poëtes femmes, des écrivains femmes, des artistes femmes. Étudiez leurs œuvres, ouvrez-les au hasard ! A la deuxième ligne, et sans savoir de qui elles sont, vous êtes prévenu ; vous sentez la femme ! Odor di femina. Mais quand elles ont le plus de talent, les facultés mâles leur manquent aussi radicalement que l’organisme d’Hercule à la Vénus de Milo, et pour le critique, c’est aussi clair que l’histoire naturelle (Barbey d’Aurevilly 1878 : XXII).
Bref, au tournant du siècle, bien qu’en général l’opinion des hommes de lettres à l’égard de la présence de leurs consœurs dans le domaine littéraire était apparemment plus modérée, l’opinion de fond de ces derniers était toujours la même. La plupart d’entre eux continuait de s’obstiner à ne pas reconnaître en elles des « créateurs », « en méprisant chacune [d’entre elles] au nom de la médiocrité de l’ensemble » (Planté 2015 : 35). Et si l’une faisait preuve d’un génie et d’un talent incontestables, on cherchait tout de suite à en attribuer le mérite à l’influence du mari, de l’amant ou du maître – peu importait qui, pourvu qu’il fût un homme – ; ou bien on leur décelait une anomalie cérébrale (Slama 1981 : 51), une « tendance à la virilité qui aurait expliqué une puissance intellectuelle anormale chez une femme » (Planté 2015 : 31). Exception faite alors de ces cas extraordinaires, en général le bataillon des femmes-auteurs se voyait inexorablement renvoyé à la catégorie de « littérature féminine », c’est-à-dire, en suivant la perspective masculine, à une « sous-littérature » basée sur la différence, sur la « spécificité féminine », et par conséquent sur l’infériorisation. C’est ce que Béatrice Slama définit génialement comme la « littérature du manque et de l’excès » : manque des qualités du génie mâle ; excès des défauts propres – disait-on – à la nature féminine, comme la sentimentalité, la mièvrerie ou le narcissisme (Slama 1981 : 53). Curieux processus de classification qui privilégiait l’identité sexuelle sur la réalité textuelle, visant à perpétuer ainsi la suprématie de l’homme dans le domaine littéraire
Il demeure que pour les critiques, les éditeurs, les jurys, les Académies, les historiens de la littérature, ce micro-univers où se décident l’édition, la diffusion, les conditions de la réception et la consécration des œuvres littéraires, les femmes écrivains ont toujours été femmes avant d’être écrivains. Et jusqu’à une période récente, l’institution n’a cessé de faire jouer contre elles la discrimination et l’infériorisation. Méfiance de l’éditeur, silence, mépris ou condescendance de la critique – et la galanterie en est une forme – exclusion » (Slama 1981 : 52).
Toujours est-il que, depuis son irruption dans la sphère littéraire à la fin du XVIIIème siècle et au cours du XIXème, la femme-auteur subira une importante évolution dans la façon de se conduire en dépit de l’hostilité du contexte. L’auteur de « Cinq mille femmes de lettres » constatait déjà ce changement dans l’attitude de ses contemporaines lorsqu’il se demandait « où [était] l’époque où la femme de lettres rougissante apportait, noué d’une faveur rose ou bleu de ciel, un manuscrit timide à un éditeur en général rogue, misogyne et d’un accès difficile, sinon impossible » (Anonyme 1907 : 165). De fait, au tournant du siècle nous retrouverons une femme de lettres de plus en plus réaffirmée dans son identité d’auteur et de femme et qui revendiquera désormais avec une autorité ferme non seulement sa place dans le domaine littéraire en tant que créatrice, mais aussi son statut en tant que femme. Séverine, écrivaine et journaliste féministe, dans un article paru dans Le Journal en 1896, se montrait comblée de joie pour les importantes avancées faites dans ce sens :
[…] la prévention est vaincue. Ces dix dernières années ont été fécondes pour l’avenir féminin. Derrière les quelques privilégiées qui ont réussi, les autres arrivent… légion ! Toutes les professions dites libérales (médecine, droit, peinture, sculpture, gravure, art appliqué à l’industrie, pédagogie supérieure, exploration aux lointains pays) comptent au moins une femme ayant acquis l’estime cérébrale des hommes, et pouvoir de traiter avec eux à égalité. […] Or, la floraison littéraire est particulièrement magnifique. En tous les genres, quelque fille d’Hypathie-la-Blonde triomphe ; apporte, à la genèse des temps nouveaux, sa part de clarté, son rayon d’astre ; le plus pur, le plus joyeux ou héroïque effort de son cerveau !
Toutes bataillent – même lorsqu’elles semblent rire ! Toutes, perfides, en un geste d’insouciance, enfoncent l’épingle d’or au cœur d’un abus. Toutes (fût-ce les tendres !) laissent passer le bout de la griffe contre un monde qui prétendit les tenir sous son pied. (Séverine 1896 : 1)
L’envergure du rôle joué par ces femmes de lettres pionnières dans l’échafaudage d’un avenir nouveau pour celles qui les ont succédées est d’une importance inestimable et incontestable. La sienne est l’étape « de l’expérience et de la révolte personnelle » (Slama 1981 : 62). Avec leur écriture, elles ont témoigné de leur époque, de leurs désirs, de leurs indignations ; avec leurs comportements transgressifs – et tel que l’affirme Slama, le seul fait d’ « écrire, pour une femme, c’[était] déjà en soi subversif » –, elles ont proposé des modèles de conduite en-dehors des consignes de la société phallocentrique (1980 : 221). Ainsi, de façon plus ou moins consciente, les unes plausiblement avec plus d’hardiesse que les autres, ont toutes contribué à l’émancipation des femmes. La redécouverte de leurs textes, ainsi que l’étude des conditions dans lesquelles elles vécurent et écrivirent s’avèrent, par conséquent, des points incontournables non seulement pour la critique littéraire féministe mais aussi, du point de vue historique et sociologique, pour la reconstruction d’une histoire des femmes encore semée de lacunes. Peut-être ainsi, par surcroît, rendions-nous une sorte de « justice poétique » à ces femmes de lettres passées sous silence.
Parmi « les plus célèbres femmes de lettres » de 1907 qui figurent dans ledit article du Je sais tout, nous retrouvons le nom de Georges de Peyrebrune. Elle fut, en effet, une des pionnières à faire de sa plume un outil de travail et une arme de révolte. Femme, enfant naturelle, issue de la petite bourgeoisie, elle aurait été plutôt destinée par sa naissance – suivant l’ordre établi des choses dans cette société bourgeoise du XIXème siècle – à mener une vie de médiocrité et de silence, dans quelque endroit de son Périgord natal, à l’ombre d’un mari qui lui aurait fait plusieurs enfants et lui aurait offert sa protection en échange d’obéissance et dévouement. C’était, du moins, le rêve de bonheur auquel elle pouvait aspirer et qu’elle accepta a priori volontiers tel qu’elle l’affirmera des années plus tard lors d’une entrevue : « Je rêvais une existence paisible, toute remplie par les soins et les devoirs du foyer : moucher des marmots et tourner des confitures » (Bernard 1898 : 5). Elle épousa donc à ses dix-neuf ans Paul Adrien Numa Eimery, un employé de mairie, pour qui elle n’éprouvera jamais le moindre sentiment amoureux ou passionnel, mais plutôt un profond dégout. Vite réveillée du rêve d’une union heureuse par une réalité brutale, l’existence qu’elle découvrit auprès de M. Eimery résulta vite insupportable pour cette jeune femme douée d’une imagination et d’une sensibilité spéciales. Elle envisagea le suicide plusieurs fois ; elle n’y osa jamais. Ce sera alors paradoxalement dans la ruine familière et dans l’absence d’enfants qu’elle trouvera l’excuse pour se justifier aux yeux des autres, mais aussi aux siens propres, de rompre les amarres avec ce mari souvent malade, très probablement aussi infidèle et intellectuellement aux antipodes d’elle2.
Georgina de Peyrebrune portait en elle l’inquiétude de l’écriture depuis sa plus tendre enfance ; adolescente, elle s’était même faite publier par quelques journaux locaux. Et, à présent devenue maîtresse de son propre destin, elle décidera de faire de sa passion son gagne-pain.
Aux lendemains de la guerre de 70, elle vient à Paris avec quelques manuscrits dans sa valise et une lettre de recommandation pour Arsène Houssaye. C’est de la main de ce dernier, puis de Tony Révillon, qu’elle donnera ses premiers pas dans le monde littéraire, mais il lui faudra attendre la décennie 80-90 avant de connaître la notoriété grâce au succès remporté par certains de ses titres comme Marco (1881), Gatienne (1882), Jean Bernard (1882) et Victoire la Rouge (1883). Elle composera sans relâche, de façon à ce que sa production s’élèvera à plus de trente-deux volumes en tout une vingtaine d’années plus tard, qu’elle verra d’ailleurs publiés chez des éditeurs de renom tels que Dentu, Ollendorff, Charpentier, Calmann-Lévy ou Lemerre, et dans le feuilleton des grandes revues, comme La Revue des Deux Mondes, La Revue Bleue, La Vie Populaire ou le Gil Blas. Certains de ces ouvrages seront également traduits à l’italien, à l’espagnol, au portugais et à l’allemand, et publiés soit dans la presse étrangère soit dans des volumes indépendants. Son roman Gatienne sera adapté au théâtre et sa nouvelle Lou Floutaïre, transposée en un opéra sous le titre Janie pour le Grand Théâtre de Genève. Deux autres romans, Vers l’Amour et Au pied du mât lui vaudront l’honneur d’être lauréate de l’Académie française en 1896 et 1899 respectivement. En 1904, elle se trouvera parmi les membres du premier jury du Prix Vie Heureuse – préfiguration du prix Femina.
Cette provinciale, qui ne comptait que sur elle-même pour s’introduire dans le monde littéraire parisien, n’étant ni fille, ni femme, ni amante de personne pouvant lui servir d’aval (Socard 2011 : 83) réussit à s’y faire une place considérable par le seul mérite de son travail. Respectée de ses contemporains – hommes et femmes –, tant pour son talent que pour sa réputation de femme honnête, elle tissera un réseau de contacts et d’amitiés dans les sphères littéraire, sociale et politique qui n’était en rien négligeable, auquel elle eut souvent recours pour demander des services en sa faveur ou pour quelque protégé.
Pourtant, la notoriété de George de Peyrebrune, comme pour la majorité des écrivains, ne fut pas sans les difficultés matérielles et immatérielles propres à leur office. Ces difficultés devenaient pour les femmes « infiniment plus terribles » (Woolf 1992 : 78) : de constantes interruptions à la maison, des altérations de la santé, une pression pour gagner de l’argent pour vivre, un recours obligé à des protecteurs et une nécessité d’« affronter marchandage et mépris dans l’espoir de (se) vendre » (Planté 2015 : 171).
La correspondance entretenue par la romancière, avec ses consœurs notamment, constate cette réalité. Ainsi, par exemple, dans une lettre datée du 24 juin 1886, Rachilde partage avec Peyrebrune son avis sur le fait que « quand une femme de lettres n’est pas une catin il faut au moins qu’elle puisse avoir l’air de l’être » (Sánchez 2016 : 53) et dans une autre occasion, elle insinuera « toutes les autres tribulations [qu’elles devaient] passer sous silence » (Sánchez 2016 : 67). Le fait est que la prostitution de la femme de lettres – soit volontairement ou sous des coactions – auprès des éditeurs et des hommes de pouvoir dans la sphère littéraire ou politique, était une pratique malheureusement assez étendue à cette époque-là. Georges de Peyrebrune en fera une critique acharnée dans Le Roman d’un Bas-bleu (1892) dans le but de lancer un « cri d’alarme […] vers les romanesques aspirantes du régiment des bas-bleu » (Peyrebrune 1892 : 258-259). Ainsi, dès ses débuts dans la profession de romancière, Sylvère, l’héroïne, sera prévenue par son maître du prix à payer pour gagner la gloire.
Ma chère, le monde est ainsi : il faut, pour qu’il accepte une femme, qu’elle lui soit imposée, j’allais dire garantie par un homme, son mari ou son amant, peu importe ! Quant aux hommes dont vous attendez l’appui, ils ne s’intéresseront à vous que s’ils en espèrent quelque chose, c’est-à-dire tout.
Or, vous dépendez d’eux, absolument. Quel que soit votre talent, et il est réel, incontestable, vous n’arriverez à rien, à lutter toute seule. […] c’est tout naturel ; vous êtes jolie, on vous désire, on essaie de vous obtenir en vous offrant, en échange, la gloire que vous êtes venue chercher dans la bataille littéraire, comme on vous offrirait des perles si vous étiez une coquette et des petits hôtels si vous étiez une courtisane. Vous n’avez pas à vous plaindre ; c’est à vous d’accepter ou… (Peyrebrune 1892 : 12-13)
Emportée par la colère, Georges de Peyrebrune « écrira dans la rage » (Woolf 1992 : 104), insérant sa propre voix dans le texte à certaines occasions pour lancer une attaque contre les abus de l’homme face à la passivité des institutions.
Cela ne vaut rien pour une femme de venir au monde pauvre et chaste. Il n’y a pas de place pour celle-là dans aucun groupe social. Quel que soit le travail qu’elle entreprenne pour gagner sa vie, elle n’y parviendra pas sans payer à l’homme la dîme de sa chair soumise ou révoltée. Depuis la servante jusqu’à l’artiste, depuis l’ouvrière des fabriques jusqu’au bas-bleu, la femme qui travaille seule, non défendue par un mâle, légitime ou non, sera violée, avec ou sans son consentement, mais elle le sera ou elle crèvera de misère. Et cela, dans le plein épanouissement de notre société démocratisée, bénisseuse et morale, et inventrice des pullulantes bonnes œuvres. (Peyrebrune 1892 : 327)
Le Roman d’un Bas-bleu n’est pas un cas isolé de protestation contre les injustices faites aux femmes, la peinture de la féminité douloureuse et la révolte contre la condition féminine étant très récurrentes chez l’auteur.
La grande majorité des romans de Georges de Peyrebrune renvoie à la question du sort réservé aux femmes et aux rapports entre les sexes. Les destins de femmes qu’elle dépeint soulignent les obstacles douloureux qui sont source de souffrances, d’humiliations et souvent d’échecs. Les personnages masculins y apparaissent presque toujours comme des figures qui, de diverses manières étouffent le désir d’autonomie, d’épanouissement digne et d’émancipation des héroïnes. (Socard 2011 : 97)
C’est que, bien qu’elle ne puisse pas se dire féministe en toutes lettres, Peyrebrune se sent certainement attachée à la cause des femmes. Depuis petite, elle vivra de près une série d’expériences qui lui feront mettre en question l’ordre établi dans les rapports homme/femme. Le vécu de sa mère, séduite par un homme riche, puis abandonnée ; sa propre expérience du « viol légal » subi la nuit de noces ; les turpitudes auxquelles elle se vit sans doute exposée tout au long de sa carrière ; et l’influence des féministes notables, comme Séverine, qui comptaient parmi ses amies, auraient constitué pour Georges de Peyrebrune un désapprentissage progressif des principes et des préjudices machistes inculqués pendant son éducation de fille. Toujours est-il que, parfois, en raison de cette morale patriarcale installée dans le plus profond de son esprit, elle aura du mal à se libérer de certaines idées conservatrices qui la mèneront inévitablement à tomber dans des contradictions3. Conséquence de tout cela, loin de l’esprit d’une militante, le féminisme de Georges de Peyrebrune doit être plutôt compris comme étant « le fruit d’un bilan personnel, d’une révolte, ainsi que du désir de contribuer à l’émancipation générale de la femme » (Socard 2011 : 88).
Grâce à l’écriture, elle prendra conscience des malheurs de la condition féminine et se servira de sa notoriété et du pouvoir détenu dans sa plume pour lutter contre l’injustice de cette situation, même si cela impliquera parfois sacrifier l’art en faveur du contenu de son message.
— […] Et, je l’avoue à ma honte, la question d’art est quelquefois subordonnée à la vérité brutale, à moins que l’art lui-même ne me serve à rendre plus précis et plus étincelants les arguments dont je me sers ; comme des pierreries au pommeau d’une épée, qui sont inutiles pour la blessure, mais dont l’éclat fascine et charme le regard ennemi. (Peyrebrune 1892 : 172)
Or, dans le processus de création de ses personnages, elle douera le plus souvent ses héroïnes de ses mêmes convictions, mettant en conflit leurs rapports avec les personnages masculins qui symboliseront à leur tour les pesanteurs morales de la tradition patriarcale et phallocentrique.
Afin de mieux comprendre le parti pris par l’auteur dans la diffusion des nouveaux patrons de comportement féminins, nous avons considéré pertinent de faire une brève étude de caractères illustrative de ceci. Ainsi, parmi l’éventail d’héroïnes inventées par Georges de Peyrebrune, nous en avons choisi trois qui, à notre avis, incarnent de façon plus évidente les changements qui commençaient à être présents dans la manière de penser et de se tenir au monde chez les femmes de la fin du XIXème siècle.
La première, l’héroïne du roman Gatienne (1882), est une jeune fille honnête, candide et complètement ignorante en matière sexuelle. Elle ressent toutefois un certain attrait physique envers son voisin, Robert, un jeune homme bien portant étudiant en Médecine, prototype du don Juan. Sans à peine savoir ce qu’elle se faisait, Gatienne se laisse enjôler par le séducteur, qui profite de la naïveté de la jeune fille pour abuser d’elle. Possédée une fois, pour la pensée de l’époque, Gatienne passait à appartenir à cet homme pour toujours. Robert est prêt à l’épouser, plus motivé par le désir de s’emparer définitivement du corps de la femme que par le sens d’un devoir à accomplir envers elle. Mais voilà que l’héroïne, faisant preuve d’une logique hors du commun, se révolte contre le malfaiteur et le refuse.
— Me relever d’une faute par une lâcheté ? Jamais. C’est alors que je serais déshonorée, répondit gravement la jeune fille, dont le front se levait dans une fierté sauvage. C’est alors que je serais avilie devant ma conscience. Notre union ne serait de ma part qu’un calcul ignoble dont la pensée me fait horreur ? Non, je suis libre et je resterai libre. Vos droits sur moi, je les nie. Je m’appartiens, et je me garde… (Peyrebrune 1884 : 79-80)
Gatienne s’approprie de son propre corps, clame sa liberté et se dit « victime d’un attentat », mais point responsable d’une faute qui n’était pas la sienne. Après tout, « Quel mal avait-elle fait ? » (Peyrebrune 1884, 96). Elle prend la décision de rester célibataire et de se passer de l’amour, pourvu qu’elle n’ait jamais à avouer cet épisode à personne. Mais elle manque à son dessein après connaître Fabrice. Le doute la hantera toutefois avant d’accepter de devenir l’épouse de celui-ci. Nous assistons alors à une réflexion hardie sur la double moralité des lois sociales :
[…] devait-elle tromper l’honnête homme qui la croyait pure ? Peut-être !…
Un vague sentiment d’égalité morale lui rappelant que l’homme n’est tenu, lui, à aucun aveu, elle pensait : Et pourquoi la femme ? La société l’ordonne ainsi : c’est sa loi. Une loi que l’homme a faite. Eh bien, si elle, la femme, la repoussait ?
Quoi ! victime et flétrie ?
Lui est le voleur, et elle est l’infâme ?
Elle est dépouillée, et il faut qu’elle demande grâce ?
Elle porte le stigmate d’un crime qui n’est pas le sien, et elle en doit faire l’aveu sous peine d’indignité ?
Et la femme se résout à ces ignominies ? Elle souffre qu’on déchire ainsi les voiles où sa pudeur s’abrite ?
Eh ! n’a-t-elle pas le droit de se soustraire à ces hontes, de se défendre contre ces lâchetés, lorsqu’elle le fait dans la sincérité de sa conscience ?
Gatienne, livrée à la logique inflexible qui avait formé son jugement, sentait une volonté virile s’emparer d’elle et la relever de l’abaissement moral que les préjugés voulaient lui infliger.
Non, elle ne devait nul aveu à Fabrice, qui ne lui en devait aucun. (Peyrebrune 1884 : 96-97)
Il arrive cependant que le mari, lors d’une conversation avec Robert, avoue partager lui-aussi ces préjugés sociaux ignorant qu’il condamnait ainsi indirectement son épouse :
– La femme appartient à son premier possesseur.
– C’est mon avis, conclut Fabrice. A moins de n’appartenir jamais à personne, légitimement j’entends ; car le mariage, même sans amour, ne va point sans cette sorte de jalousie rétrospective qui fait aux femmes une obligation et un devoir d’apporter leur virginité à l’hymen. (Peyrebrune, 1884: 202-203)
Le bonheur conjugal brisé, Gatienne se suicide se sentant impotente face au pouvoir de suggestion d’une morale sociale implacable envers la femme.
Une histoire tout à fait différente est celle qu’on nous raconte dans La Margotte (1887). Ici, l’homme, Étienne – un jeune écrivain –, n’est plus un séducteur infâme. Il séduit, certes, la jeune fille pauvre et ignorante, mais il accomplie sa promesse de lui donner une éducation qui l’aide à grimper dans l’échelle sociale et se montre de même prêt à l’épouser lorsqu’elle accouche un enfant. Il s’acharne alors, à la façon d’un pygmalion, à faire de la Margotte une femme digne de lui, mais « sa création », ce « chef-d’œuvre » animé, finit par se retourner contre lui comme le monstre de Frankenstein.
Pauvre petite fille, inculte d’abord, timide et douce ; puis, peu à peu réveillée, tirée de son ignorance, développée, grandie, grandie, ayant atteint le niveau intellectuel de ceux qui avaient consenti à la faire monter jusqu’à eux pour la recevoir dans leur rang, et maintenant, ne s’arrêtant plus et continuant à grimper comme une liane folle qui jette toujours plus haut ses frêles et tenaces crochets.
Après l’avoir couvée avec une tendresse de père et de créateur, penché sur elle, un peu comme sur un berceau, voilà qu’Etienne aujourd’hui la regardait d’en bas, car elle le dépassait maintenant, elle le dominait, devenue à son tour l’être supérieur dans son ascension triomphante. (Peyrebrune s.d. : 167)
La Margotte, reconvertie en une nouvelle femme – Marguerite – grâce à une éducation exceptionnelle, commence à avoir ses propres inquiétudes, ses propres vœux : elle veut devenir artiste. Étienne, qui l’« avait créée pour lui, pour lui seul », « refuse avec son autorité de chef, de maître » cette tentative d’émancipation (Peyrebrune, s.d. : 295). Mais alors, loin de s’y conformer, Marguerite coupera le lien avec son créateur et prendra la fuite auprès d’un poète lui rendant la liberté de devenir la femme qu’elle veut être réellement.
C’est la liberté aussi, mais la liberté sexuelle plus particulièrement, ce que réclame l’héroïne de la nouvelle Dona Juana (1888). Et dans sa protestation, elle insiste sur le caractère pernicieux du modèle de vertu imposé par la société patriarcale, qui ne fait que des femmes insatisfaites, malheureuses ou soumises, toujours inférieures dans leurs rapports avec les hommes.
[…] vous, les hommes, les êtres libres, nés et grandis avec la conscience de cette liberté qui vous laisse, sans remords et sans honte, savourer toutes les joies de la passion partagée ? Mais nous, condamnées par l’état de conscience même que l’on nous a fabriqué à la pureté ou du moins à la fidélité éternelle, nous subissons toutes les affres de cette condition contraire aux lois naturelles, ou bien les tortures des plus douloureuses hontes, si nous avons le malheur de nous affranchir. Nous faisons de vous des dieux, dites-vous, mais vous faites de nous des infâmes et des prostituées ; ce qui fait votre joie et votre suprême orgueil fait notre abaissement. Vous avez des souvenirs et nous avons des remords (Peyrebrune, 1888 : 5).
Ferme dans ses convictions, dona Juana s’en passera de cet idéal de femme vertueuse et donnera libre cours à son cœur, laissant derrière elle tout un éventail d’hommes trompés et morts d’amour.
En quête d’un idéal de perfection, elle n’est pas prête à « aliéner [sa] liberté » en faveur d’un amant quiconque pour toute sa vie sous aucun concept (Peyrebrune 1888 : 6). Elle ne prône donc qu’un droit de choix égal à celui qu’exercent les hommes : voilà l’argument qu’elle donne dans sa défense auprès de sa dernière conquête.
— […] Depuis un mois que vous me priez d’amour, si bien qu’hier, enfin, je vous ai répondu, à peu près, que je vous aimais, vous ai-je demandé compte de votre vie passée, de vos amours défuntes ? Quel âge avez-vous, Monsieur de Parny ? Le mien, je suppose : trente ans. Combien de femmes avez-vous aimées, séduites, trompées, abandonnées, désespérées peut-être jusqu’à l’infamie ou jusqu’à la mort, depuis vos vingt ans seulement jusqu’à ce jour ? Répondez…
[…]
— Le nombre vous échappe, n’est-ce pas ? C’est si naturel qu’on laisse une femme, alors qu’on ne l’aime plus ? Qui songerait à s’en étonner et à s’en souvenir ? On doit y mettre des formes, voilà tout, quand on est bon gentilhomme. Mais s’il plaît à une femme, déjà fort malheureuse et confuse d’avoir cédé, de vouloir reprendre sa liberté alors qu’elle a cessé d’aimer, c’est une autre affaire. Et si le malheur veut que l’abandonné ne puisse se consoler, la femme est… ce que vous disiez tout à l’heure, Monsieur, une misérable. Car elle doit traîner éternellement le boulet des tendresses mortes, quand il vous sied à vous de le détacher avec la plus sereine désinvolture. (Peyrebrune 1888 : 14-15).
Malheureusement, cette héroïne se heurtera comme les autres contre le mur de la double morale patriarcale. Elle mourra aux mains d’un amant incapable d’accepter l’inversement des rôles entre homme et femme en termes de domination.
Le choix de ces trois personnages n’a pas été fortuit. Nous prétendions mettre en évidence le fait que la domination de l’homme sur la femme est un problème qui touche indifféremment tous les niveaux de la société. Gatienne, Margotte et Juana représentent chacune, effectivement, un milieu social différent : l’une est une petite bourgeoise ; l’autre, une paysanne pauvre ; et la dernière, une comtesse. Et toutes les trois voient venir, chacune à leur tour, un homme qui étouffera leurs aspirations au nom d’une autorité suprême leur étant accordée depuis des siècles de tradition patriarcale.
Il n’est pas non plus étonnant qu’elles en résultent toutes punies de leurs audaces, l’auteur étant censée de se plier encore au conservatisme des critiques, des éditeurs et du lectorat si elle voulait bien se faire publier. Néanmoins, elle s’arrange à donner aux dénouements de ses histoires une certaine ambiguïté, car en même temps qu’elle rend la satisfaction aux lecteurs de voir condamnés les comportements irréguliers de ces femmes – avec la mort dans le cas de Gatienne et de dona Juana ; avec le mépris social et l’enlèvement de son enfant, pour ce qui est de la Margotte –, une sensation reste dans le subconscient : peut-être que les fautes de ces héroïnes n’étaient pas telles.
Mais s’il y a une véritable transgression chez Georges de Peyrebrune, celle-ci réside, dans notre opinion, dans le fait d’avoir tiré ces femmes de leur statut d’ « éternelles mineures » tout en leur attribuant un esprit critique. Car, en effet, une femme capable de réfléchir sur sa condition ne se livrera jamais aux abus de l’homme sans avoir livré bataille auparavant. Et, comme, pour Georges de Peyrebrune c’est par le biais de la possession du corps que l’homme exerce sa domination sur la femme, la réaction logique de ses héroïnes sera de s’approprier d’abord de leurs propres corps pour devenir par la suite les maîtresses de leur propre destin.
À force d’être répété par Peyrebrune et par ses consœurs, ce message – aussi lucide et sage que novateur et subversif – de la nécessité de se rebeller contre les injustices du système patriarcal percera lentement l’âme et l’esprit des lectrices. Semer le grain du changement : celle-ci fut la contribution des femmes de cette première étape de l’histoire du féminisme pour la construction d’une nouvelle femme, libre et émancipée.
Hélas, l’importance du rôle joué dans l’Histoire par ces femmes pionnières est restée pendant longtemps, et reste encore aujourd’hui, ignorée par beaucoup. C’est à nous, les chercheurs, de les rendre justice.
La notoriété de Georges de Peyrebrune expira pendant les premières années du XXème siècle, qui est la date du début d’un déclin progressif jusqu’à l’oubli absolu. Elle meurt dans l’indigence et la détresse, en novembre 1917, et son nom, comme celui de tant d’autres femmes, s’effaça de l’histoire. Elle laissa pourtant pour la postérité, dans ses œuvres et dans sa correspondance, le témoignage de son vécu personnel, les preuves des tracas subis dans sa lutte pour l’émancipation et l’empreinte de son cri de révolte contre l’indignité de la situation faite aux femmes. Et, grâce à ceux-ci, nous pouvons aujourd’hui lui restituer la place qu’elle mérite dans l’histoire de la littérature, dans l’histoire des femmes.
Bibliographie
ANONYME (1907) : « Cinq Mille Femmes de Lettres ». Je sais tout : magazine encyclopédique illustré. Paris : Publications Pierre Lafitte, vol. 32, 159-166.
BARBEY D’AUREVILLY, Jules (1878) : Les Bas-Bleus. Les Œuvres et les Hommes, t. V. Paris ; Bruxelles : Victor Palmé ; G. Lebrocquy.
BERNARD, Jean (1898) : « Les petites enquêtes du Figaro : L’idéal à vingt ans ». Le Figaro, nº 247, 5.
ENA BORDONADA, Ángela (2001) : « Jaque al Ángel del hogar : Escritoras en busca de la nueva mujer del siglo XIX », (Mª José Porro Herrera). Romper el Espejo : La Mujer y la Transgresión de Códigos en la Literatura española : Escritura. Literatura. Textos (1001-2000), Córdoba : Servicio de Publicaciones de la Universidad de Córdoba, 89-111.
NESCI, Catherine (2011) : « Bas-Bleu ou femme de plume ? La littérature au féminin selon Daumier et Gavarni », (José-Luis Díaz). Le Magasin du XIXe siècle, nº1, La femme auteur, 53-61.
PEYREBRUNE, Georges de (1884) : Gatienne, (2e édition). Paris : C. Lévy.
— (1888) : « Dona Juana ». La Grande Revue de Paris et de Saint-Pétersbourg. Nº6, 1-15.
— (1892) : Le roman d’un Bas-Bleu. Paris : Ollendorff.
— (s.d.) : La Margotte. Paris : La librairie illustrée.
PLANTÉ, Christine (2015) : La petite sœur de Balzac : essai sur la femme auteur. Lyon : Presses universitaires de Lyon.
SÁNCHEZ, Nelly (2016) : Georges de Peyrebrune. Correspondance : De la Société des gens de lettres au jury du prix Vie heureuse. Paris : Classiques Garnier.
SÉVERINE (1896) : « La Littérature Féminine ». Le Journal, nº1418, 1.
SLAMA, Béatrice (1980) : « Femmes écrivains » (Jean-Paul Aron). Misérable et glorieuse la femme du XIXe siècle. Paris : Fayard, 213-243.
— (1981) : « De la “littérature féminine” à “l’écrire-femme” : différence et institution ». Littérature. Nº44, L’institution littéraire II, 51-71. [http://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1981_num_44_4_1361 ; 16/10/2015]
SOCARD, Jean-Paul (2011) : Georges de Peyrebrune (1841-1917) : Itinéraire d’une femme de lettres, du Périgord à Paris. Périgueux : Arka.
WOOLF, Virginia (1992) : Une chambre à soi (A Room of One’s Own). Paris : Denoël.
1 Héritier de la pureté représentée par la Vierge Marie depuis le Moyen Âge, l’« ange du foyer » s’impose comme idéal féminin à travers l’Europe à partir de la seconde moitié du XIXème siècle, en particulier grâce au succès du poème The Angel in The House que Coventry Patmore dédia à la mémoire de son épouse en 1854. Cet idéal prônait un modèle de femme soumise et dévouée, limitée à son rôle au sein du ménage, a la fois qu’il exaltait sa féminité (Ena Bordonada 2001 : 90). Il choquait frontalement avec l’image diabolique de la femme-auteur, « buveuse d’encre et catin littéraire », émancipée et avec une certaine tendance à la virilité, qui incarnait « plusieurs hantises : la fin du mariage et du bonheur domestique, la dissolution des mœurs, l’émasculation des maris, le renversement des rôles sexués » (Nesci 2011 : 53, 57).
2 Bien qu’émancipée à Paris, Georges de Peyrebrune venait passer les saisons estivales dans la maison conjugale à Chancelade jusqu’à la vente de cette propriété en 1906. Nous avons trouvé dans la correspondance de la romancière des allusions à la mauvaise santé de M. Eimery à plusieurs reprises. Ainsi, pendant ces séjours, elle aurait eu à le soigner dans quelque occasion d’une maladie aux yeux. À partir de la vente de la « villa Peyrebrune », ses visites deviendront moins fréquentes sinon inexistantes, mais elle continuera de s’intéresser à l’état de santé de son mari auprès de Pierre Petit, l’abbé de Carlux, qui semble rester ami du couple. Elle n’aurait donc jamais délaissé complètement cet homme, même si en fin de comptes il n’était qu’un étranger pour elle. Or, la romancière témoigne aussi dans sa correspondance personnelle et professionnelle d’un besoin constant d’argent qu’elle ne dépensait guère en elle, le train de vie qu’elle menait à Paris étant en général assez modeste. Envoyait-elle cet argent à son mari ? Dans quel but : entretien de la maison, règlement de dettes, paiement de quelque traitement médical ? N’ayant trouvé jusqu’à présent aucune trace d’une correspondance entre ces deux époux, la réponse à cette question reste encore un mystère.
3 L’un des exemples les plus étonnants de cette attitude contradictoire de Georges de Peyrebrune par rapport à ses vœux d’émancipation pour la femme est sa réaction de refus absolu, en 1884, aux propositions du Congrès pour faire de nouvelles concessions aux femmes en matière de droits civils et d’émancipation politique (Socard 2011 : 101).